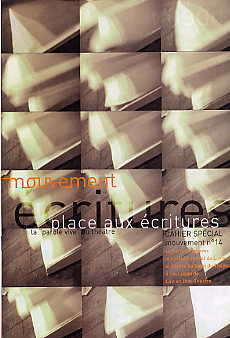| Les
auteurs sont morts, Vive les auteurs, par Bruno Tackels.
Les auteurs sont morts, vive les auteurs. C’est une
fâcheuse habitude de notre époque, ou alors une lâcheté
paresseuse, que de ne savoir honorer les écrivains dramatiques
qu’après leur mort. Eux vivants, rien ne semble pouvoir inscrire
et défendre leur présence dans l’espace artistique.
C’est quand ils quittent le champ que l’appareillage culturel
devient capable de construire leur légitimité d’artiste.
Il faut donc oser poser la question ; pourquoi les écrivains ne
peuvent-ils exercer pleinement, et de leur vivant, leur activité,
en tant que métier? Pourquoi les métiers de l’écriture
(fiction, traduction dramaturgie, surtitres, etc...) résistent-ils
à toute inscription sociale légitimante ? Il est possible
d’être (et de vivre en étant) graphiste, metteur en
scène ou éclairagiste – il est impensable de vivre
(au démarrage) en écrivant des pièces ou en traduisant
Shakespeare.
Cette absence de statut social provient indirectement d’un "état
de total isolement" de l’écriture théâtrale,
comme l’analyse très finement Jean-Pierre Han dans le quatrième
numéro de la revue Frictions . Pour comprendre ce phénomène
de marginalisation, il se réfère à Michel Vinaver
: "[...] le théâtre a su rompre ses attaches avec le
territoire de la littérature ; ce faisant, conséquence peut-être
inattendue, il s’est séparé de l’ensemble du continent
culturel." Difficile de savoir si cette rupture est pensée
comme un bien ou comme un mal pour l’écriture théâtrale.
Il y a sans doute plusieurs manières de comprendre cette étrange
exclusion. En suivant les réflexions d’Artaud, on peut dire
que le théâtre gagne tout à prendre son congé
de la littérature. C’est elle qui l’empêche de
vivre pleinement ce qu’il a à être. La scène
n’est pas d’abord, ni essentiellement littéraire. Sans
aller jusqu’à dire, lecture forcée, que le texte doit
disparaître du plateau, il est vrai qu’Artaud dit bien qu’il
se méfie du texte, trahison et empêchement du corps parlant.
Toute la question est de savoir si cette rupture d’avec le texte
littéraire a permis aux écritures théâtrales
de trouver d’heureuses conjugaisons avec la scène. Quittant
l’espace du livre pur, quel destin vont-elles trouver ? Force est
de constater que les liaisons fécondes ne sont pas légions.
L’écrivain-pour-le-théâtre (communément
nommé "auteur" dans le paysage subventionné) n’a
visiblement pas réussi à engager un dialogue véritable
avec le plateau du théâtre.
Ni écrivain, ni homme de théâtre, "l’auteur"
reste au milieu du gué. Cette malaisante suspension n’est
certainement pas de son seul fait. Les directeurs de théâtre
participent largement à cette injuste mise au ban. Il n’est
qu’à lire leur prose, dans le cadre d’une récente
enquête conduite par le journal Libération. Sous la plume
d’un des "poids lourds" du théâtre public
(entendez : les mieux dotés et les plus "inventifs" des
directeurs de théâtres subventionnés), on relève
cette "réflexion" qui laisse rêveur : "Koltès,
Gabily, Lagarce sont morts, on attend les successeurs. Il y a assèchement
de l’écriture dramatique en France. On a tendance à
oublier que le théâtre est fondé par le texte."
Je ne sais pas très bien qui se cache derrière ce "on"
paresseux ou sans courage. Sûrement des professionnels qui ne font
pas leur travail. Ceux qui tirent de tels constats n’assument pas
les missions qui leur sont confiées. Ils n’ont pas dû
mettre en oeuvre les "comités de lecture" que le Ministère
de la Culture avait désiré et financé. Car s’ils
l’avaient fait, ils n’en seraient pas là. Ils ne nous
resserviraient pas, dans la rubrique "créations", des
textes de Brecht, Feydeau, Tchekhov, Musil ou Copi. Il n’est pas
question de sous-estimer ces écritures, juste affirmer qu’elles
ne peuvent masquer celles qui nous arrivent aujourd’hui. Et pour
qu’elles nous parviennent, il faut des relais, des passeurs, des
observateurs : de ceux qui font de l’art une affaire vivante, et
non le reliquat d’un patrimoine mortifère.
Imaginez deux minutes qu’un directeur de théâtre dise
à Koltès, vivant, qu’il sera joué au détriment
de Py ou de Durringer. Un tel cauchemar n’est malheureusement pas
juste dans nos rêves, la réalité des "programmateurs"
du théâtre public montre clairement qu’un écrivain
mort parle mieux de l’actualité qu’un homme qui vit notre
monde aujourd’hui. L’attaque tourne autour de l’idée
suivante : les auteurs vivants ne savent plus parler du réel concret.
Ils sont incapables d’écrire dans la foulée des guerres
qui nous arrivent, d’Auschwitz à Tchernobyl. Et puis, suprême
argument, de la guerre des Balkans, personne ne saura nous donner le point
de vue des serbes.
Là encore : faute professionnelle, paresse de comptoir. Les écrivains
serbes sont massivement plébiscités. Avant la guerre comme
après, rien n’empêche de suivre le travail des écrivains
de Serbie, comme Simovitch, montéé par Jean-Paul Wenzel
ou Srbjanovic par Thomas Ostermeier en Allemagne et André Wilms
en France. Affirmer que les écritures contemporaines ne traduisent
pas la réalité de nos guerres est tout simplement bête,
indigent ou malhonnête. Au choix. Quelques textes, au hasard, pour
préciser.
Dans les Hommes dégringolés, Christophe Huysmans parle
du Moyen Orient. Dans une langue intime et pleine de réserves,
il dit comment ces guerres inextricables affectent nos corps. Dans La
Promise, Xavier Durringer renoue avec le noeud qui fait les grandes tragédies.
Là aussi, mais dans une tout autre langue, la guerre ethnique déchiquète
les êtres et montre violemment qu’on ne peut plus choisir son
camp, tant la quête vendettale pousse au charnier généralisé.
Joris Lacoste travaille également depuis ces événements,
depuis la déportation contemporaine, d’après Auschwitz,
notamment dans un texte écrit pour (par) la radio, Ce qui s’appelle
crier. Dans le cadre d’un spectacle fleuve, "les Récits
de naissance", construit sur dix années, et conviant de nombreux
auteurs à écrire des formes courtes, Roland Fichet a traversé
de nombreux conflits. Dans Tombeau chinois, il reparcourt les violences
non cathartiques de la place Tian an Men. Dans ses pièces (Pluie
de cendres), comme dans ses romans (Cris), Laurent Gaudé fait parler
ceux qui reviennent du front, ou qui restent pris dans les rets d’un
siège perdu. Yann Apperry, dans les Hommes sans aveu, la parole
devient acte de résistance face à une guerre que l’on
ne voit pas. Olivier Py vient de confier l’Exaltation du labyrinthe
à Stéphane Brauschweig. Cette pièce s’écrit
les ruines d’une guerre qui n’a jamais dit son nom, celle que
la France est allée mener en Algérie, et plus loin au sud.
Dans un spectacle plein de tensions, intitulé "Rwanda 94",
toute l’histoire de ce génocide est longuement disséquée,
restituée jusqu’aux limites de l’insoutenable, à
travers les textes de Jean-Marie Piemme. Quand Pascal Rambert décide
de monter Gilgamesh, premières traces d’écritures humaines,
c’est pour affronter l’inhumaine monstruosité occidentale
pendant la guerre du Golfe. Bruno Boussagol vient de monter un spectacle
sur Tchernobyl, à partir d’un texte de Svetlana Alexievitch,
une journaliste russe qui avait déjà écrit Des Cercueils
de Zinc, un recueil quasi insoutenable de témoignages sur la guerre
d’Afghanistan qu’avait monté Didier Gabily au début
des années 90. Quant à Auschwitz, depuis Paul Celan jusqu’à
Mickaël Glück ou Patrick Kermann (je pense à son incroyable
A), on ne compte plus ceux qui sont traversés, plus ou moins directement,
par l’extermination. Et que fait François Tanguy (lui qui
“fait des phrases avec les phrases des autres”), avec son Théâtre
du Radeau, porté par l’injonction d’exposer les cauchemars
de la raison occidentale, mise en miettes par les batailles de la raison
occidentale?
Face aux attaques portées contre l’écriture, il est
facile d’allonger la liste de ceux qui la font vivre – mais
est-ce d’ailleurs la bonne réponse ? Ne faut-il pas plutôt
dénoncer l’obscénité de la question posée
? Reprocher aux écrivains de ne pas écrire nos tragédies
revient à une double insulte. Celle de ne pas les lire et celle
de croire qu’on peut leur dicter un texte-qui-va-marcher. Mais pour
qui donc se prennent ces intendants ? De quel droit osent-ils s’affranchir
du rôle qui leur est imparti : servir et accompagner les artistes
qui travaillent ?
D’origine monarchique en France, le terme d’intendant dit bien,
en Allemagne, qu’il s’agit d’un rôle de gestionnaire
et d’administrateur du théâtre : alter ego du dramaturge,
l’intendant gère la maison. Nos "intendants" français,
neuronalement paralysés, étouffés par une royauté
ministérielle exsangue, n’ont pas compris qu’ils utilisent
un terme qui les dénonce. C’est qu’ils ne lisent pas,
ou si peu, quelques coupures de presse et les conférences de presse
de la Ministre. Cela suffit pour une année. Quant aux réels
"comités de lecture" qui seuls pourraient donner du crédit,
professionnel, à leur constat d’une écriture asséchée,
ils n’existent dans presque aucune de ces maisons, pourtant richement
dotées, et largement incitées, par les Ministres successifs,
à engager ce type de travail prospectif.
Comment peut-on asséner des résultats aussi péremptoires
quand on ne se donne aucun moyen rigoureux de les vérifier ? Il
faudrait analyse plus longuement les raisons de ce désamour entre
les gérants de maisons et leurs écrivains. Et pourquoi ces
administrateurs de théâtre ont-ils su, en revanche, pactiser
avec les metteurs en scène ?
“Ecrivez-nous des pièces sur l’actuel, et nous les produirons”.
Sur le plan strictement dramaturgique, cette injonction à l’actuel
est une pure bêtise. Jamais aucun dramaturge n’a écrit
la guerre de son temps immédiat. Quand Shakespeare écrit
Richard III, la guerre des Roses est finie depuis trente ans. Et puis
comment peut-on imaginer qu’un réel écrivain fasse
de la guerre un sujet ? Les jeunes morts pré-panthéonisés,
les Lagarce, les Koltès ou les Gabily n’ont jamais pris la
guerre pour thème. Elle court plus ou moins directement dans l’écriture,
mais elle n’est pas objet du récit – d’ailleurs
comment pourrait-on objectiver la guerre, la sans-objet par excellence
? Certes Müller ou Gabily disent à quel point leur écriture
est agie par nos effondrements politiques – c’est moins affirmé
chez Lagarce ou chez Koltès, même s’il est aussi question
chez eux d’un deuil qui n’arrive à son terme.
Toujours l’écriture est processus d’altération,
une opération qui métamorphose la réalité
dont elle rend compte. Pour lire, il faut donc pouvoir lire. Seuls les
poètes de la scène savent entendre les poètes du
livre. Et de telles rencontres, de plus en plus, ne cessent d’avoir
lieu, discrètement, magiquement : Valère Novarina et Claude
Buchwald, Philippe Minyana et Robert Cantarella, Tarkos et Emmanuelle
Huynh, Matéi Visniec et le marionnettiste Alain Lecucq, Elsa Sola
et Philip Boulay. Leslie Kaplan et le théâtre des Lucioles.
Et tant d’autres encore.
Dans l’un de ses plus beaux textes, A, Patrick Kermann se laisse
traverser par l’histoire de l’Allemagne, dont le récit
se laisse partager en deux langue, l’allemande et la française.
Cet oratorio minimal appelle une force de jeu hors du commun. Les intendants,
s’ils jouaient vraiment leur partition, sont là pour susciter
des rencontres, de réelles rencontres d’artistes. Mais pour
jouer A, difficile de compter sur Kristine Scott Thomas ou Fanny Ardant
pour faire le "produit d’appel". Peu intéressant,
donc, pour les intendants. Ils n’ont pas lu le texte, ne le liront
jamais. Sauf s’ils découvrent que l’auteur de ces lignes
est mort. Ils pourront alors l’ajouter dans la liste de leurs éloges
funèbres d’un art qu’ils croient encore pouvoir assassiner.
Illusoire croyance que leur pouvoir, désir d’artiste manqué,
impuissance de négociants qui n’ont même pas d’affaires,
de réelles affaires, à négocier, ni même la
belle jubilation du commerce. La vraie violence est que leur existence
ne laissera même pas de cendres, pas même un nom dans le journal.
La vraie violence est que les poètes, longtemps, resteront dans
le marbre de nos souvenirs. Notre courage est de leur faire confiance.
Le 2 août 2001
© Bruno Tackels
|