La Ville fond de Quentin Leclerc
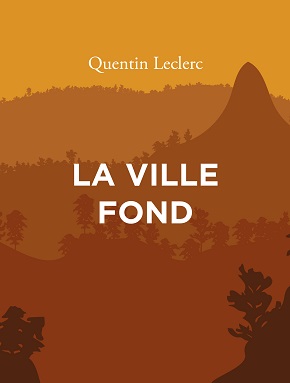
« Les fragments s’écrivent comme séparation inaccomplies ; ce qu’ils ont d’incomplet, d’insuffisant, travail de la déception, est leur dérive, l’indice que, ni unifiables, ni consistants, ils laissent s’espacer des marques avec lesquelles la pensée, en déclinant et se déclinant, figure des ensembles furtifs qui fictivement ouvrent et ferment l’absence d’ensemble, sans que, fascinée définitivement, elle s’y arrête, toujours relayée par la veille qui ne s’interrompt pas. » — Maurice Blanchot, L’écriture du désastre.
Cité par Quentin Leclerc en ses Relevés.
On ignore quand le monde se dérobe sous nos pieds, on croit encore marcher alors que l’on coule. La ville fond et personne n’a conscience de ce que cela entraîne, que tout ce qui s’effiloche, se dégrade, brûle et meurt est provoqué par la ville qui fond. Tout le monde veut aller en ville mais elle reste inaccessible. Et l’ignorance de tout cela rend le drame terriblement attachant, comme l’on est attaché plus ou moins par mégarde et lassitude à une servitude collective et consensuelle.
Pourtant, depuis que la ville fondait, bien des choses avaient changé. Bram n’en savait rien encore.
« La ville fond. » Ce leitmotiv inquiétant et fantastique va rythmer les péripéties de deux manières. La première, c’est que nous pouvons, au minimum, émettre de sérieux doutes sur la possibilité, pour Bram et pour le chauffeur (du bus), de rejoindre un jour sains et saufs la ville. La seconde, c’est l’aspect fantastique de cet énoncé : comment la ville peut-elle, réellement, fondre ? Force sera de constater qu’effectivement, quelque chose se passe pour modifier ainsi les événements, les paysages, les gens, les vies. Quelque chose se passe, puis la même chose se passe encore, de manière légèrement différente, légèrement dégradée, corrompue, quelque chose cloche dans un décor, dans un corps, dans une structure sociale. Comme des univers parallèles. Et malgré ces changements – village pas au bon endroit, forêt puis pas de forêt, ou inversement, bus en cendre puis bus tout neuf, puis bus à pneu crevé, puis de nouveau en cendre, route menant nulle part, villageois devenus policiers, tombes fleurissant – tout reste, au fond, identique.
Depuis que la ville fondait, le mécanicien avait disparu et les habitants fuyaient. Cela, Bram et le chauffeur l’ignoraient.
Des répétitions, au sens théâtral. Des scènes presque identiques, des personnages jouant presque les même rôles. Des reboots d’un même film, jusqu’à la nausée, des niveaux d’un jeu vidéo à reprendre du début à chaque réveil. Les villageois sont-ils des villageois ou des policiers déguisés ? Ou inversement ? Les rôles sont joués par différents acteurs, les costumes changent mais les fonctions restent. On se retrouve toujours, la veille en compagnie de ses semblables dans une remorque, et le lendemain, abandonné au bord d’un bois, livrés à une quelconque milice dont les membres sont interchangeables, parfois même correspondent être pour être avec les villageois que l’on a connu. Il ne nous reste plus, comme à Bram, qu’à enfiler le costume de l’ennemi pour passer inaperçu et, de l’intérieur, se mettre à le comprendre. C’est, parfois, seulement parfois, un monde où l’on oublie les prisonniers dans les cellules. Simplement ça, imaginer un prisonnier politique buter contre le mur étatique, pourrir au sens littéral en prison, simplement oublié, pas seulement de tous, mais même des policiers qui l’ont enfermé et du pouvoir qui a voulu le placer là. Mais ce sera aussi autre chose – répétitions, modifications – une façon discrète de tout faire sans cesse basculer, par quelques mots, quelques noms, scènes revue et corrigée, légers décalages, brouillages, et ces rêves imbriqués vraiment surprenants qui nous saisissent car au moment de se réveiller avec Bram, on sait qu’il n’y a pas de rêve et que tout, d’une certaine façon est vrai, y compris le faux vraiment faux du rêve.
La langue de Quentin Leclerc, d’une simplicité confondante, par simple je veux dire évidente, directe — un peu comme fait Echenoz : quelque chose qui n’a l’air de rien et nous surprend après coup quand on est quelque part où l’on ne s’est pas vu arriver. Langue qui parvient à raconter toute la complexité et la folie de cet univers insensé et logique à la fois. Car c’est le village du Château de Kafka auquel il est difficile de ne pas penser...
Tous ces temps-ci je pense et repense de plus en plus à ma vie. J’en cherche la faute capitale : la source de tout le mal, celle que j’ai sans doute commise, sans arriver à la découvrir.
Franz Kafka, Recherches d’un chien. Cité par l’auteur en ses Relevés
...sauf que dans La Ville fond les empêchements d’atteindre la ville ne sont pas d’ordre légaux. Tout le monde cherche à atteindre la ville, par convois entiers, jour et nuit, à se battre. La loi est d’ailleurs fondée sur cet objectif, sans sélection, sans restriction, tout le monde au bout d’un moment aide Bram en ce sens – le Château à l’envers – mais personne n’y arrive. Mauvais sort collectif, si le bonheur est à poursuivre, ce ne sera pas ensemble...

Cathédrale St Joseph, Le Havre. Photo de l’auteur.
Bram n’avait aucune envie d’aider le maire en lui révélant l’identité du vrai chauffeur, car il les avait déjà tous deux enfermés une première fois, et Bram ne savait pas de quoi les policiers étaient capables, ce qu’ils feraient une fois rendus en ville. Ce qu’ils feraient de la ville, et ce qu’ils feraient de lui, Bram. [...] Comme personne ne répondait à l’appel du maire, celui-ci proposa à ceux qui le souhaitaient de monter avec lui dans le bus, et aux autres de faire le chemin à pied soit vers la ville, soit vers le village, soit vers où diable ils voulaient, cela ne le regardait plus. Hors Bram et le chauffeur, tous les policiers montèrent dans le bus. Le pare-brise était encore rouge du sang de l’ancien faux chauffeur, et le nouveau policier-chauffeur dut l’essuyer de sa manche pour dégager la vue. Le maire demanda à Bram et au chauffeur s’ils ne regrettaient pas leur choix [...]
La fin est somptueuse et je n’en dis rien, si ce n’est qu’il fallait réussir l’exploit de pouvoir terminer ce texte, un texte fait de répétitions, de modifications où tout pourrait continuer sans fin ou s’arrêter brusquement comme un roman inachevé, mais ce qui fond fond de plus en plus, et peut-être qu’à la fin, qui vous cueille, quelque chose s’évapore et s’envole. Une façon de dire, peut-être, que le bonheur, s’il est possible, même s’il ne relève que d’une contingence (trouver une pharmacie), même s’il peut se produire un seul instant qu’il faudra quitter aussitôt, existe.
Je me souviens du début du texte, sur les Relevés de l’auteur, désormais hébergés chez lui [1] et que j’ai relu pour écrire cet article. J’ai relu aussi ce qui précède immédiatement le début des mésaventures de Bram, un texte sur le mur que j’avais oublié, que je me suis souvenu avoir lu mélangé à la fonte de la ville :
Le mur avait quelque chose d’instable. Quand on s’approchait pour toucher une brique, la brique disparaissait, laissant sa place à une autre, identique. Le mur n’était pas très large, bouchait l’allée d’une ruelle, faisait l’impasse. Les deux bâtiments adjacents étaient quelconque, deux immeubles d’habitation, probablement. On descendait dans la ruelle les poubelles, on y faisait des trafics, tuait au pire. Il y faisait nuit tôt. Le mur était là, on ne le questionnait pas. On y tapait parfois au poing, énervé, abruti. On s’y adossait. On a voulu l’abattre. Beaucoup y sont allés à la masse, à la pioche ; ils y ont perdu tous leurs outils. Il s’agissait de ne pas altérer le mur. Le mur avait pour vocation d’être mur, et rien ne devait l’entamer. Toute tentative de destruction serait vouée à l’échec. Toute tentative d’effacement empêchée. On aurait pu agrandir le mur, l’élever ; à quoi bon. Il était déjà infranchissable. On pouvait évidemment le contourner, mais de l’autre côté, il était le même. Que se trouvait-il entre ses deux faces. Qu’y avait-il derrière. Quelqu’un avait écrit à sa droite : ici se trouve la vérité. Et s’il suffisait de s’y couler ?
La Ville fond, Quentin Leclerc. Éditions de l’Ogre, 07/09/2017.
ISBN : 979-10-93606-94-1, 208 pages.
C’est son deuxième roman, après Saccage.
Le site de l’auteur : http://quentinleclerc.com/