Hélène Gaudy | Le petit peuple obscur du crime et du canapé

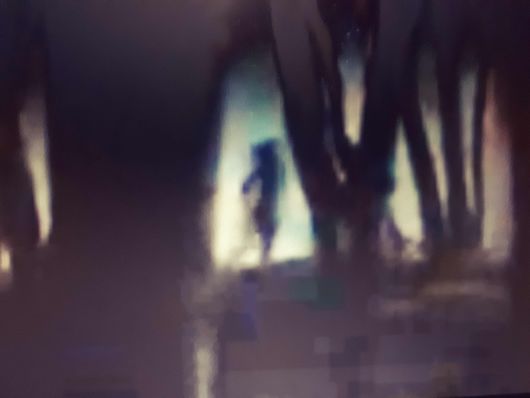


Je ne regarde plus, donc, que ce que l’on appelle des « polars », séries ou téléfilms policiers, genre qu’il ne m’arrive jamais de lire mais qui est devenu, à la télévision, le seul capable de me plonger dans cet état de latence proche, sans doute, de ce que Patrick Le Lay appelle le temps de cerveau disponible, fait de longues plages flottantes, tièdes et solitaires, où quelque chose de l’ordre de la réflexion cesse de fonctionner et où s’éveille un autre type de perception, plus nébuleux, plus souterrain, ayant davantage à voir avec les instants qui précèdent le sommeil qu’avec la stimulation d’un divertissement.
J’ai été étrangement lente à réaliser que mes aspirations télévisuelles s’étaient à ce point réduites jusqu’à ne plus ressembler qu’à un seul téléfilm, dont chaque soirée serait un épisode et qu’on ne parviendrait à suivre, d’un œil distrait, qu’en s’accommodant du fait que les personnages n’aient pas toujours le même visage, puisque l’essentiel, finalement, restait inchangé.

Lorsque cela m’est apparu, j’ai d’abord été saisie d’une inquiétude légitime sur ma santé mentale. En quoi la contemplation sans cesse réitérée de la découverte d’un corps et de l’enquête qui s’ensuivait pouvait bien être la seule chose capable de me détendre ? Et surtout : ces séances hypnotiques ne risquaient-elles pas de me faire plus de mal que de bien ?

Puisque je continue, malgré cette tardive prise de conscience, à enchaîner les séries policières et leurs corollaires bon marché que sont les téléfilms à suspense, j’ai fini par admettre que, quelque part, le schéma immuable selon lequel ils étaient bâtis devait activer en moi une chose dont je ne pouvais me passer, une chose inconnue encore mais qui méritait, peut-être, d’être explorée.
Qu’il s’agisse des séries « haut de gamme » — les nordiques, avec leur inimitable atmosphère poisseuse, sont de loin mes préférées — ou des vulgaires déclinaisons de meurtres atroces des séries américaines comme Esprits criminels, elles me font toutes plus ou moins le même effet. Je suis, face à ces programmes, extrêmement bon public, comme si mon esprit critique qui, si je faisais l’effort de le consulter, me permettrait peut-être de faire la différence entre une série passionnante et un vulgaire navet, n’était plus, face à ces images, aucunement connecté à l’autre part de moi-même, celle qui s’abreuve sans discernement de crime et de sang. Ma limite n’est atteinte que face aux polars régionaux de France 3, Meurtres à l’île d’Oléron ou bien à Carcassonne, tant il me semble que le chant des cigales et la lourdeur comique des dialogues font mauvais ménage avec la seule chose qui m’intéresse : le crime.
Je supporte mal qu’on l’enrobe, le crime, dans les oripeaux de la légèreté ou, pire, de la gaudriole, qui plane entre les murs des chambre d’hôtel au papier peint passé de ces fictions « terroir » où traîne toujours, quelque part, le fumet du poulet basquaise ou du cassoulet.
Le crime, à mes yeux, s’accommode mal du second degré. Il m’en faut du premier, du littéral, et le moins de folklore possible. Si ces conditions sont remplies, je peux à peu près tout regarder. Et il semblerait que je sois loin d’être la seule. Si les chaînes multiplient à ce point les films et les séries construits sur le même modèle précis, c’est bien qu’il y en a beaucoup d’autres comme moi, tout un petit peuple obscur du meurtre et du canapé qui adore, comme l’avoue Patti Smith avec qui je partage une passion sans borne pour la série The Killing, se blottir sous un plaid, au fond de ce qui ressemble le plus possible à une grotte, sans chercher à partager ces moments qui ne s’adressent qu’à soi, qui auraient presque quelque chose de honteux, tant la part qu’ils réconfortent peine à se montrer au grand jour.@

Si les pulsions morbides ne sont sans doute pas tout à fait étrangères au goût douteux que l’on cultive pour ce type de programmes, je me raccroche à la pensée qu’elles ne sont pas la seule motivation qui nous anime. Autre chose, peut-être, nous tient rivés à nos sanglants écrans — une chose qui serait de l’ordre de la réparation.
Dans un polar, le meurtre n’est qu’un début. La fin de toute chose en devient l’origine, le commencement — de là à en déduire qu’on peut espérer un au-delà après la mort, il n’y a qu’un pas. Dans un polar, quelque chose, forcément, vient après.
Un corps, donc, est trouvé. Dans une ruelle sombre, un appartement dévasté, une mise en scène barbare ou le plus simple appareil, dans un port, un cargo, un train ou au bord d’une rivière, dans un champ, au fond d’un lac ou à l’arrière d’une voiture — les scénaristes ne manquent pas, sur ce point, d’imagination, le lieu où est découvert le corps étant souvent, du film, la principale originalité.

Jusque-là, le corps était seul. Abandonné. Personne ne se souciait qu’il se décompose quelque part, à l’abri des regards. Grâce à un heureux hasard, il est examiné, scruté — sauvé.
Sur l’état de ce corps, les scénaristes ne manquent pas non plus d’idées. La fameuse série Esprits criminels sus-citée est certainement, en la matière, l’une des plus imaginatives. La perversion des tueurs n’y a aucune limite et les marques qu’elle laisse sur les cadavres des victimes sont plus atroces les unes que les autres, trop atroces, presque, pour être décrites ici alors que les découvrir sur l’écran ne m’a jamais traumatisée.
Justement et d’abord pour cela : le corps est trouvé. Il n’est plus seul, quelqu’un s’occupe de lui.

Étrangement, si horriblement mutilé soit-il, si méconnaissable, personne ne fait de syncope à sa vue. Tout au plus aperçoit-on parfois un débutant vomir dans un coin, ou a-t-on droit à des phrases badines du genre « c’est pas beau à voir ». Puis on retourne qui à son autopsie, qui à son enquête, qui à son café. Le rôle du café, puisqu’on en parle, est loin d’être négligeable. Dans les pires moments d’attente ou d’angoisse — quand, par exemple, on apprend à des parents que leur enfant a disparu, autre grand ressort des polars —, les personnages parviennent, toujours, à acquiescer quand on leur propose un café. Et ça, je trouve ça très réconfortant.
Parfois, ils le prennent à emporter, comme dans le remake américain de The Killing dans lequel l’héroïne, Sarah Linden, pourtant peu à l’aise avec les sentiments, finira par avouer à son coéquipier que les meilleurs moments de sa vie, les seuls, à dire vrai, à avoir été à peu près supportables, ont été ceux où elle a partagé avec lui, derrière les vitres embuées de leur voiture, un café.
C’est un détail, peut-être. Mais ce que cela dit, surtout, ce que cela martèle même, c’est qu’il reste possible, même quand on vient de perdre un enfant ou qu’on se retrouve nez-à-nez avec un cadavre atrocement mutilé, de prendre, ensemble, un café.
Le coéquipier est, lui aussi, un incontournable de la série policière. Le coéquipier ou la coéquipière, généralement mal assorti à son coéquipier ou sa coéquipière : une flic mal dégrossie voire légèrement autiste avec un flic affable par exemple, comme dans The Bridge, autre série nordique, ou vice-versa. Tous deux finissent, toujours, par apprécier leurs différences et par boire du café avec bonheur dans des voitures glacées, même au cœur d’une ville hostile livrée à la violence et au crime.
Les coéquipiers, parfois, sont toute une bande. Dans Esprits criminels, ils sont assez nombreux pour disputer un tournoi de poker et tous unis dans une entente fraternelle malgré leurs divergences de caractères. Le potentiel rassurant du clan qu’ils forment culmine en la personne de Garcia, blonde excentrique experte dans les recherches les plus pointues qui résout toutes les énigmes derrière l’écran de son ordinateur, affublée de coiffures et de lunettes improbables, tout en appelant chacun par son petit sobriquet — capital sympathie partagé, d’ailleurs, par un nombre considérable de médecins légistes, comme si seules leurs bonnes blagues pouvaient permettre de supporter le chapelet d’horreurs qu’ils profèrent en ouvrant le ventre des cadavres.
Donc, non seulement le corps est trouvé, mais se penchent sur lui comme une série de bonnes fées tout un aréopage d’enquêteurs et d’enquêtrices bourrues mais sympathiques qui ne vont avoir de cesse que de lui rendre son identité, de retracer sa vie, de le sortir des limbes où il était plongé.

Pour ajouter au réconfort, ces séries ont le bon goût de se dérouler dans tout un chapelet de lieux types, de paysages que nous reconnaissons immédiatement comme des chambres interdites enfermées en nous-mêmes, à force de les voir, de les arpenter.
Il y a les parkings souterrains où les tueurs se cachent derrière les voitures, attendant de frapper. Il y a les champs noirs, à l’orée des forêts, dans lesquelles les jeunes filles sont chassées comme du gibier. Il y a les ports ruisselants de pluie jamais sèche, collants de sel et d’alcool. Il y a les caves aux doubles murs derrière lesquels se languissent les enfants kidnappés, les maisons d’architectes aux immenses baies vitrées ouvertes sur les bois bleus, les pavillons de banlieue, les piscines illuminées, les bicoques so british de l’inspecteur Barnaby, les garages où les tueurs ourdissent leurs crimes quand, dans les appartements des inspecteurs, s’amoncellent les verres vides et les photos punaisées au mur qui reconstituent, en constellations, la vie nébuleuse des victimes.

Nous traversons ces lieux en ne les regardant qu’à moitié — nous les avons vus si souvent. Quelque chose en nous les reconnaît, y est déjà allé. Ils sont comme ces étapes des voyages initiatiques, mais des étapes descendantes, qui nous tirent vers le bas au lieu de nous élever, jusqu’à ce que le fond soit touché, le crime élucidé et qu’on puisse, d’un coup de pied, remonter.
Ce à quoi on assiste, en passant par toute une série de passages obligés — la découverte du corps, l’autopsie, l’annonce de la mort aux proches, leur convocation, un à un, au commissariat, les différents fils que les enquêteurs tirent pour, enfin, résoudre l’énigme — s’apparente, finalement, à un long processus de deuil, qui redonne au corps une identité, une famille et surtout, à sa mort, une explication. Le corps n’est plus tout à fait mort pour rien : on trouve son meurtrier, qui comme il se doit sera puni. On comprend ses raisons, si cruelles soient-elles, puisque tout le monde a les siennes. Quelque chose est effacé de la gratuité révoltante du meurtre, de la solitude révoltante du cadavre. Il est rendu à sa famille. Il va pouvoir être enterré, et cela rend finalement assez accessoires les rouages de l’enquête et les péripéties du polar.
J’avoue ne les suivre que d’un œil, gardant l’autre rivé à une préoccupation plus souterraine, cette réparation du corps, ce processus de deuil qui n’en finit pas de s’opérer, et qui trouve une conclusion particulièrement parlante à la fin de chaque épisode de la série Cold Case où les morts, une fois élucidées les circonstances de leur meurtre, reviennent assister aux derniers instants de l’épisode et errent, spectres contemplatifs et bienveillants, parmi les vivants qui les ont sortis des limbes, révélant la nature profonde du polar : un exorcisme.

Les enquêteurs, les enquêtrices, êtres fracassés aux vies le plus souvent réduites aux mystères qui les obsèdent, ont malgré tout été capables d’aider les morts à passer de l’autre côté, de leur faire franchir le fleuve noir et d’en débarrasser les vivants. C’est aussi à cette libération que nous assistons, tout voyeurs que nous sommes, et à la fin de chaque épisode, on peut espérer que les fantômes se sont faits un peu moins nombreux, moins erratiques et désespérés, voire qu’ils se sont décidés, pour certains, à débarrasser le plancher, nous laissant avec le souvenir déjà flou d’un épisode dont nous avons oublié les ressorts narratifs mais dont nous gardons l’impression vague d’avoir perdu quelque chose et d’en être, une fois de plus, allégé.
